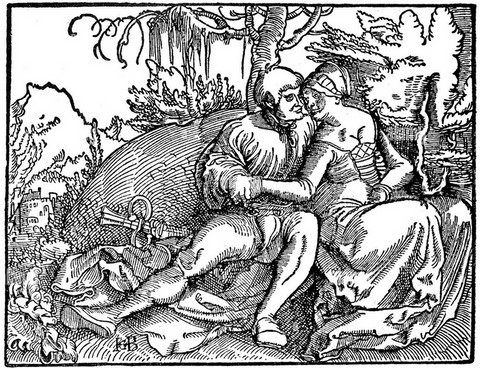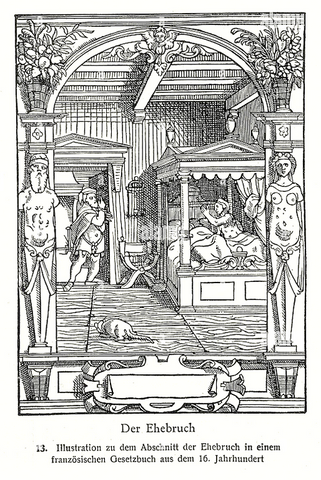Les frasques scandaleuses de noble François Bourdon
L'épisode en bref
Bienvenue sur « Vraiment Calvin, est-ce là une vie idéale ? Un podcast historique ». Aujourd’hui, cap sur Genève au XVIe siècle, où l’on découvre que même les familles les plus distinguées n’étaient pas forcément des modèles de vertu — en témoigne François Bourdon, notable bien en vue… mais catalogué client régulier du Consistoire.
Sous le regard scrutateur de Calvin et de ses alliés, la Réforme œuvre à bâtir une société pieuse, réglée comme du papier à musique. Pourtant, François Bourdon, héritier d’une famille influente et citoyens au bénéfice de riches connexions, accumule les démêlés pour… disons, des aventures sentimentales un peu turbulentes et immorales. Fornications à répétition, adultère, soupçons de sorcellerie, et même accusations de viol, ses frasques auraient pu lui valoir la disgrâce… mais la réalité se montre plus nuancée.
Entre repentances publiques, amendes plutôt clémentes et tolérance intrigante liée à son statut social (sans oublier le fameux la surprenant mention du « célibataire indulgent » des registres), Bourdon illustre la difficile conciliation entre idéaux moraux sévères et poids des privilèges.
Aussi, plongeons ensemble dans les horloges bien réglées du Consistoire, où la justice divine se frotte parfois à la politique, où la rigueur rencontre les failles humaines, et où la sainteté n’exclut pas quelques zones d’ombre. Une leçon d’histoire qui montre que, même dans la Genève la plus puritaine, l’humain reste… humain.
On appuie sur lecture ?
Si vous préférez une autre plateforme audio (Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Overcast...), cliquez ICI !
*******
Script
Speaker #0 - Bonjour. Aujourd'hui, on plonge un peu dans les archives de Genève au XVIe siècle. On va regarder comment la société réformée gérait ce qu'on appelait la paillardise.
Speaker #1 - Oui, l'inconduite sexuelle en gros.
Speaker #0 - C'est ça. On a des extraits d'analyse, des bases de données sur les registres du Consistoire. Et on va suivre quelques personnes, surtout François Bourdon, un célibataire assez influent.
Speaker #1 - Exact ! Et on va comparer son cas avec d'autres, comme Jean-Philibert Guex et Jean Alliod. pour voir un peu comment la justice morale pouvait varier.
Speaker #0 - Voilà ! L'idée, c'est de décrypter comment le statut social, le fait d'être marié ou non, les réseaux, tout ça pouvait jouer.
Speaker #1 - Tout à fait. On est donc à Genève, juste après la Réforme. Le Consistoire, c'est cet organe qui veille de très près sur la morale publique.
Speaker #0 - Et ces archives, elles nous montrent quoi ? Une tension, j'imagine ?
Speaker #1 - Exactement. Une tension entre les idéaux très stricts et puis la réalité sociale. C'est plein de nuances.
Speaker #0 - Alors commençons par ce François Bourdon. Qui c'est ce monsieur ?
Speaker #1 - Alors Bourdon, c'est un citoyen genevois, célibataire et issu d'une famille très très en vue.
Speaker #0 - Ah oui ?
Speaker #1 - Oui, son père Jean Bourdon était un riche marchand drapier. Il était aussi conseiller. Sa mère Jacquema, c'était la sœur du premier syndic Claude Savoie, le top du top quoi.
Speaker #0 - D'accord. Et lui-même François ?
Speaker #1 - Lui-même, il était membre du Conseil des 200, donc un organe politique important, co-seigneur de Compois, quelqu'un de bien établi.
Speaker #0 - Pourtant, une des premières accusations qu'on trouve, c'est qu'il aurait paillardé avec sa servante Jeanne et eu un enfant, baptisé à la papisterie.
Speaker #1 - C'est ça, baptisé catholique. Et ça, c'était que le début en fait. Les archives montrent une série d'affaires.
Speaker #0 - Racontez un peu.
Speaker #1 - En 1545, cette histoire avec Jeanne de Lajoux, la servante, l'enfant baptisé catholique, sanction. Il doit crier merci à Dieu et à la justice, payer six écus d'amende et les frais.
Speaker #0 - Ok. Et après ?
Speaker #1 - 1547, rebelotte, avec la même Jeanne de Lajoux. Un autre enfant illégitime. Puis, entre 47 et 48, une liaison avec Robelle Recland. Elle, elle était mariée.
Speaker #0 - Ah ! Adultère donc ?
Speaker #1 - Oui. Ils sont tous les deux brièvement emprisonnés. Amende, cinq florins chacun, crier merci, les frais.
Speaker #0 - Et ça continue ?
Speaker #1 - Oui. 1548, une accusation de viol sur une certaine Jeannette d'Aumange à Compois. Là, c'est plus grave. Il fait un mois de prison, mais il est libéré contre 15 florins d'amende, crier merci, les frais.
Speaker #0 - 15 florins pour une accusation de viol ? Ça paraît léger, non ?
Speaker #1 - Ça peut sembler léger, oui. Et puis en 1550, on le soupçonne d'avoir un livre d'enchantements, peut-être avec son beau-frère médecin.
Speaker #0 - Un livre d'enchantements ?
Speaker #1 - Oui ! Bon, les détails sont flous, mais ça montre encore un écart par rapport à la norme religieuse. Et enfin, en 1552, une autre liaison avec une servante, encore une Jeanne. Un autre enfant illégitime. Il est libéré après sa peine, paie une amende.
Speaker #0 - C'est là que ça devient vraiment intéressant. Malgré toutes ces affaires, dont certaines très graves comme le viol, les sanctions semblent, comme vous disiez, relativement clémentes. Pourquoi ?
Speaker #1 - Alors, les sources suggèrent deux choses. Sa richesse et ses relations, évidemment. Mais aussi, et c'est peut-être crucial, son célibat.
Speaker #0 - Ah bon ? Pourquoi le célibat ?
Speaker #1 - Dans cette société très patriarcale, on pardonnait plus facilement les pulsions d'un célibataire, même notable, que l'infidélité d'un homme marié qui brisait un sacrement et un ordre familial.
Speaker #0 - C'est fou ça.
Speaker #1 - Il y a même un témoin qui rapporte l'avoir entendu se vanter en prison disant qu'il voulait « sept bâtards » avant de se marier.
Speaker #0 - Sept bâtards, carrément !
Speaker #1 - Lui-même aurait dit devant le consistoire par jeu qu'il en voulait trois ou quatre. Bon, par jeu, mais quand même.
Speaker #0 - Donc il était puni, mais différemment.
Speaker #1 - Exactement. On le punit pour la fornication, pour le baptême catholique, ça c'est un défi direct à l'ordre réformé, pour l'accusation de viol, pour le livre interdit. Mais la sanction reste mesurée par rapport à ce qu'on pourrait attendre, sans doute à cause de son statut de célibataire influent.
Speaker #0 - Et il y a aussi cette affaire politique en 1560.
Speaker #1 - Oui, plus tard, il est impliqué dans une histoire avec Jean Morly. On l'accuse d'avoir rapporté et amplifié des critiques contre les ministres. Ça lui vaut une suspension temporaire du Conseil des 200. Ça montre aussi qu'il naviguait dans les tensions politico-religieuses de l'époque.
Speaker #0 - Mettons ça en perspective. Jean-Philibert Guex, lui aussi célibataire. Liaison avec une femme mariée. Ça peine.
Speaker #1 - Alors là, c'est différent. Neuf jours de prison au pain et à l'eau, et surtout une amende très élevée : 25 écus.
Speaker #0 - Ah oui, 25 écus, c'est beaucoup plus que les 5 ou 15 florins de Bourdon. Pourquoi cette sévérité ?
Speaker #1 - Le contexte politique semble jouer un rôle énorme ici. Guex était le beau-fils d'un opposant politique qui avait été exécuté, Jean-Philippe, des Artichaux.
Speaker #0 - D'accord.
Speaker #1 - Donc cet amende très lourde, ça pourrait bien être une façon de le viser lui ou sa famille à travers cette affaire de mœurs. C'est un mélange de morale et de politique. Sa partenaire, Jeanne Rachex, elle a eu la même peine de prison d'ailleurs.
Speaker #0 - Et Guex avait d'autres soucis avec le consistoire, non ?
Speaker #1 - Oui, on lui reprochait aussi de manquer les sermons, de s'opposer un peu au Consistoire. Donc un profil plus contestataire, disons.
Speaker #0 - Et pour finir la comparaison, Jean Alliod.
Speaker #1 - Liaison avec sa servante. Lui, c'est le cas de base, si on veut. Puni, juxte les édits, c'est-à-dire "selon la loi", probablement la peine standard. 3 jours de prison au pain et à l'eau, 5 florins d'amende.
Speaker #0 - Bien moins sévère...
Speaker #1 - Voilà, ça montre bien le contraste. Alliod, c'est la fornication simple entre célibataire, maître et servante. Guex, c'est l'adultère aggravée par le contexte politique. Et Bourdon, c'est le notable célibataire récidiviste qui bénéficie d'une certaine mansuétude malgré la gravité et la répétition.
Speaker #0 - Donc si on résume un peu tout ça, ces exemples nous montrent une justice morale à Genève qui n'était pas tout à fait la même pour tout le monde.
Speaker #1 - Absolument. Le statut marital, célibataire ou marié, la classe sociale, les connexions politiques, tout ça pesait lourdement dans la balance pour ces affaires de paillardise.
Speaker #0 - François Bourdon, malgré des actes répétés, y compris un viol présumé et un défi religieux, s'en tire relativement bien, grâce à son statut de riche célibataire influent.
Speaker #1 - C'est ça. Et ça illustre bien les difficultés du Consistoire. Vouloir imposer une morale stricte et uniforme, c'était une chose. Le faire en pratique face au réseau de pouvoir, aux mentalités patriarcales dominantes, c'en était une autre.
Speaker #0 - Même dans la cité de Calvin, qui cherchait la rigueur ?
Speaker #1 - Même là. La clémence envers des gens comme Bourdon, ça montre peut-être les limites de leur autorité ou simplement comment fonctionnait la société de l'époque.
Speaker #0 - Et ça nous amène à une dernière pensée. Vous avez mentionné que Bourdon se serait vanté de vouloir des bâtards.
Speaker #1 - Oui, cette attitude un peu désinvolte...
Speaker #0 - Quand on pense à ce que ça impliquait pour les femmes, la honte, les sanctions, un avenir incertain, que ce soit les servantes, la femme mariée ou la victime de viol, qu'est-ce que ça nous dit cette attitude de Bourdon sur les rapports de pouvoir homme-femme à l'époque ? Sur ce qui était acceptable ou du moins toléré pour certains hommes, même sous le regard du Consistoire ?
Speaker #1 - C'est une excellente question pour réfléchir en effet. Ça révèle sans doute une asymétrie très forte, dans la manière dont la société jugeait et traitait les hommes et les femmes face à la sexualité et à ses conséquences... Matière à réflexion.
Sources
François Bourdon : un notable genevois et ses luttes contre la discipline consistoriale (1540-1550)
Introduction
Au XVIe siècle, sous l'influence de Jean Calvin et de ses compagnons réformateurs, la société genevoise connaissait une profonde transformation morale et religieuse. Le Consistoire, un organe composé de pasteurs et d'anciens, jouait un rôle crucial dans l'application de ce nouvel ordre moral, scrutant la vie des Genevois et corrigeant les écarts par rapport aux normes établies. Cet article se concentre sur un Genevois remarquable, François Bourdon, dont les rencontres répétées avec le Consistoire offrent un aperçu fascinant des tensions entre le statut social, le comportement personnel et les exigences de la discipline religieuse dans la Genève du début de la Réforme. S'appuyant sur les archives du Consistoire, les registres des Conseils et des sources secondaires, cette étude examine les accusations portées contre Bourdon, les réponses qu'il a apportées et les facteurs qui ont pu influencer la manière dont le Consistoire a traité ses affaires.
La famille Bourdon : richesse, statut social et influence
Pour comprendre la position de François Bourdon au sein de la société genevoise, il est essentiel de prendre en compte son milieu familial. Les Bourdon étaient une famille influente à Genève. Le père de François, Jean Bourdon, était un riche marchand de drap qui devint bourgeois de Genève en 1512. Jean occupa de nombreux postes importants au sein de la ville, notamment celui de membre du Conseil des Deux-Cents (CC) en 1530 et 1541, et du Conseil des Soixante (LX) de 1534 à 1540. Il fut également hospitalier de l'Hôpital général en 1536. Le mariage de Jean Bourdon avec Jacquema, sœur de Claude Savoye, renforça encore le prestige de la famille. Claude Savoye était une figure clé de la politique genevoise, ayant occupé les fonctions de premier syndic (magistrat en chef) en 1536, année de l'adoption de la Réforme, et de maître de la Monnaie de Genève.
François Bourdon hérita lui-même de ce statut privilégié. Il fut membre du Conseil des Deux-Cents en 1544 et co-seigneur de Compois avec son frère Julien, une seigneurie achetée en 1542. Julien Bourdon occupa également des fonctions importantes, notamment celle de membre du Conseil des Deux-Cents en 1541.
D'autres membres de la famille Bourdon se sont également illustrés : Gabrielle Bourdon a épousé Jacques Blondel, un syndic, et Jeanne Bourdon a épousé Jean Let le jeune, puis François Chapuis, médecin de la ville. Ce réseau de liens familiaux avec des personnalités influentes telles que Savoye, Donzel, Lect et Chapuis témoigne de la profonde intégration de la famille Bourdon dans la société genevoise. Cette position sociale élevée n'a toutefois pas protégé François Bourdon de l'attention intense du Consistoire.
Accusations de fornication : Jeanne de La Jouz et enfants illégitimes
Les archives du Consistoire révèlent que François Bourdon a été accusé à plusieurs reprises de fornication ou de paillardise. Le premier cas documenté remonte à 1545 et concerne Jeanne de La Jouz, une servante originaire d'Hermance. Bourdon était accusé d'avoir eu des relations sexuelles elle, relations qui avaient abouti à la naissance d'un enfant baptisé dans la foi catholique (« baptisé à la papisterie »). Cette accusation était particulièrement grave, car elle associait la fornication au rejet de la foi réformée.
Les registres du Conseil indiquent que Bourdon fut emprisonné et interrogé. Il refusa dans un premier temps d'avouer, ce qui entraîna une prolongation de sa détention. Finalement, Bourdon fut contraint de reconnaître son offense, et Jeanne de La Jouz fut libérée après avoir fait amende honorable (« crie merci à Dieu et à la Justice »). Bourdon, lui, fut condamné à faire de même et à payer une amende de six écus, en plus de couvrir les frais de son emprisonnement et de la procédure judiciaire.
Le cas de Jeanne de La Jouz n'était pas un incident isolé. En 1547, Bourdon fut à nouveau accusé de fornication avec Jeanne de La Jouz, qui travaillait désormais comme servante pour Henri Aubert. Cette nouvelle accusation ternit encore davantage la réputation de Bourdon et démontra un comportement qui allait à l'encontre des attentes morales du consistoire.
Robelle Reclan : adultère et confession
En 1547-1548, François Bourdon fut impliqué dans une autre affaire d'inconduite sexuelle, cette fois-ci avec Robelle Reclan, l'épouse de Jean de Gex, un boucher résidant sur le pont du Rhône. Robelle se trouva enceinte, et les soupçons se portèrent rapidement sur un des Bourdon. Au départ, Julien Bourdon, le frère de François, fut accusé à tort de cette liaison, mais le Consistoire découvrit rapidement que François était le vrai coupable.
Le Consistoire convoqua deux amants pour les interroger. Robelle admit avoir donné naissance à un enfant environ un mois auparavant et identifia Bourdon comme étant le père. Bourdon, lui, avoua avoir eu des relations sexuelles avec Robelle, qui était déjà mariée à Jean de Gex. À la suite de leurs aveux, Bourdon et Robelle furent emprisonnés le 5 mars 1548. Une semaine plus tard, ils furent libérés après s'être publiquement repentis. Bourdon fut condamné à une amende de cinq florins pour lui-même et de cinq florins supplémentaires pour Robelle. Cette affaire était particulièrement grave car elle impliquait l'adultère, une transgression considérée comme une offense grave à la fois aux vœux du mariage et à l'ordre social.
Jeannette Domenge: accusations of rape
L'accusation la plus grave portée contre François Bourdon concernait Jeannette, sœur de Georges Domenge. En 1548, Bourdon fut accusé d'avoir violé ladite Jeannette à Compois. Les archives du consistoire indiquent que Bourdon fut emprisonné pour cet acte de violence présumé. Le Conseil envoya le procureur général et le lieutenant à Compois pour enquêter sur l'affaire. Leur enquête fournit des preuves solides de la culpabilité de Bourdon, ce qui conduisit à d'autres poursuites judiciaires.
Les détails de cette affaire sont particulièrement troublants. L'accusation de viol représentait une aggravation significative de la gravité des infractions présumées de Bourdon. Alors que le consistoire avait déjà traité des cas de fornication et d'adultère, l'accusation de viol impliquait une violation flagrante de l'autonomie corporelle de la victime et une grave infraction aux normes sociales. Cette accusation plaçait Bourdon dans une position précaire, susceptible d'encourir des sanctions sévères s'il était reconnu coupable.
Malgré la gravité des accusations, Bourdon réussit à obtenir sa libération de prison le 13 septembre 1548. Les raisons exactes de sa libération ne sont pas tout à fait claires d'après les documents disponibles, mais il est probable que son statut social et ses relations familiales aient joué un rôle. Il fut néanmoins tenu d'exprimer publiquement son repentir et de payer les frais de justice, ainsi qu'une amende de 15 florins.
Possession d'un livre d'enchantement
En 1550, François Bourdon fit l'objet d'une autre accusation, cette fois-ci liée à la possession d'un livre d'enchantement. Les archives indiquent que Bourdon et Jean-François Chapuis (probablement le docteur François Chapuis) étaient soupçonnés de posséder ce livre, jugé « contraire à Dieu ». Cette accusation suggère une inquiétude quant au potentiel de la magie et de la superstition à saper la foi réformée. Les détails de cette affaire sont relativement rares, mais elle démontre la vigilance du Consistoire dans la surveillance non seulement des comportements sexuels, mais aussi des croyances intellectuelles et religieuses.
Réponse du consistoire : facteurs influençant la clémence ?
Malgré les accusations répétées et les verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre de François Bourdon, les sanctions qui lui ont été infligées semblent relativement clémentes par rapport à celles infligées à d'autres délinquants. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette apparente disparité :
- Statut social et relations familiales : La fortune et les relations familiales de Bourdon lui ont sans aucun doute assuré une certaine protection. En tant que membre d'une famille genevoise influente, il a probablement bénéficié de l'influence de ses proches et alliés au sein du Consistoire et du Conseil.
- Célibat : Le fait que Bourdon fût célibataire a joué un rôle déterminant dans la relative clémence dont il a bénéficié. Dans la société patriarcale de la Genève du XVIe siècle, les transgressions sexuelles des hommes célibataires étaient tolérées dans une certaine mesure, à condition qu'elles n'impliquent pas d'adultère ou de viol. Le Consistoire a peut-être considéré la fornication de Bourdon comme une infraction moins grave, car il ne violait pas le caractère sacré du mariage.
- Préjugés sexistes : L'indulgence du Consistoire envers Bourdon reflète peut-être également les préjugés sexistes qui prévalaient dans la société. Les hommes étaient souvent soumis à des normes de moralité sexuelle moins strictes que les femmes, et leurs transgressions étaient fréquemment excusées ou minimisées. Bourdon lui-même semblait reconnaître cette double norme, déclarant qu'il avait l'intention d'avoir plusieurs enfants illégitimes avant de se marier.
- Confession et repentir : Dans chaque cas, Bourdon a finalement confessé sa culpabilité et exprimé son repentir, même s'il était réticent au départ. Cette volonté de reconnaître ses torts a peut-être influencé la décision du Consistoire d'imposer des sanctions moins sévères.
Conclusion
Le cas de François Bourdon fournit des informations précieuses sur la dynamique de la réglementation morale au début de la Réforme à Genève. Alors que le Consistoire cherchait à imposer des normes de comportement strictes, son application de la justice était souvent influencée par le statut social, les relations familiales et les préjugés sexistes. Les démêlés répétés de Bourdon avec le Consistoire illustrent les tensions entre les idéaux de discipline religieuse et les réalités du pouvoir social. Malgré ses transgressions, Bourdon a réussi à échapper relativement facilement à la surveillance du Consistoire, grâce à sa position privilégiée et à l'attitude générale envers le comportement sexuel des hommes célibataires. En fin de compte, l'histoire de François Bourdon révèle la complexité de la vie dans une société aux prises avec les défis de la réforme religieuse et morale. Si le Consistoire visait à créer une communauté pieuse, ses efforts étaient souvent tempérés par les réalités de l'inégalité sociale et l'influence persistante des normes traditionnelles. La vie de François Bourdon nous rappelle que même dans les sociétés les plus rigoureusement moralistes, la nature humaine et les dynamiques sociales peuvent compliquer l'application des idéaux les plus stricts. Les archives du Consistoire, en capturant les nombreuses facettes de la vie d'un citoyen notable et ses luttes avec la conduite morale, soulignent l'interaction nuancée entre le statut social et l'éthique naissante de la discipline religieuse dans la Genève du XVIe siècle.
Et quelques pistes à suivre...
Quelques études de référence sur la débauche et l'adultère à l'époque de la Réforme :
- Sara BEAM, "Adultère, indices médicaux et recul de la torture à Genève (XVIIe siècle)", Genre et histoire: la revue de l'Association Mnémosyne, n° 16 (Femmes sans mari), 2015/09-11, online (web)
- Sara BEAM, "Gender and the prosecution of adultery in Geneva, 1550-1700", in Manon van der HEIJDEN / Marion PLUSKOTA / Sanne MUURLING (ed.), Women's criminality in Europe, 1600-1914, Cambridge (MA): Cambridge University Press, 2020/01, pp. 91-113 (web)
- Carolyn CORRETTI / Sukumar P. DESAI, "Fornication and illegitimacy in Reformation Geneva: cases from the Consistory, 1542-1558", Journal of family history, vol. 47, n° 4, 2022/02, pp. 452-465 (web)
- Pierre DUBUIS, "Sous la tutelle des pères et des maris", in Erica DEUBER ZIEGLER / Natalia TIKHONOV (éd.), Les femmes dans la mémoire de Genève, du XVe au XXe siècle, Genève: Éditions Suzanne Hurter , 2005, p. 32-33
- Robert M. KINGDON, Adultery and divorce in Calvin's Geneva, Cambridge (MA): Harvard University Press, 1995/03, 224 p.
- Balazs D. MAGYAR, "Fornication and adultery in the city of Debrecen (1547-1625) compared with the morality of Geneva", Verbum et ecclesia, vol. 44, n° 1, 2023, online (web)
- Augustin REDONDO, ed., Relations entre hommes et femmes en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. Réalités et fictions, Paris: Publications de la Sorbonne - PSN, 1995, 220 p.
- Michèle ROBERT, "Que dorénavant chacun fuie paillardise, oisiveté, gourmandise...": Réforme et contrôle des moeurs, la justice consistoriale dans le Pays de Neuchâtel (1547-1848), Neuchâtel (CH): ALPHIL - presses universitaires suisses, 2016, 468 p.
- Sonia VERNHES-RAPPAZ, "La noyade judiciaire dans la République de Genève (1558-1619)", Crime, histoire et sociétés, vol. 13, n° 1, 2009, p. 5-24 (web)
- Jeffrey R. WATT, "Sex in Geneva in the Sixteenth Century", in Merry E. WIESNER-HANKS / Mathew KUEFLER, The Cambridge world history of sexualities, Cambridge (MA): Cambridge University Press, 2024/04, pp. 210-231 (web)
- Elisabeth WENGLER, "Rethinking "Calvin's Geneve": women, agency, and religious authority in Reformation Geneva", Journal of the Western Society for French history, vol. 35, 2007, pp. 55-70 (web)
- John WITTE Jr., "Church, state, and family in John Calvin's Geneva: domestic disputes and sex crimes in Geneva's Consistory and Council", in Per ANDERSEN (ed.), Law and disputing in the Middle Ages, Copenhagen: Djof Publishing, 2013, p. 245-280 (web)
Projet RCnum
Ce podcast de vulgarisation historique est développé dans le cadre du projet interdisciplinaire intitulé « Édition sémantique et multilingue en ligne des Registres du Conseil de Genève / 1545-1550 » (RCnum) et développé par l'Université de Genève (UNIGE), grâce à un financement du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).